Vie et oeuvre
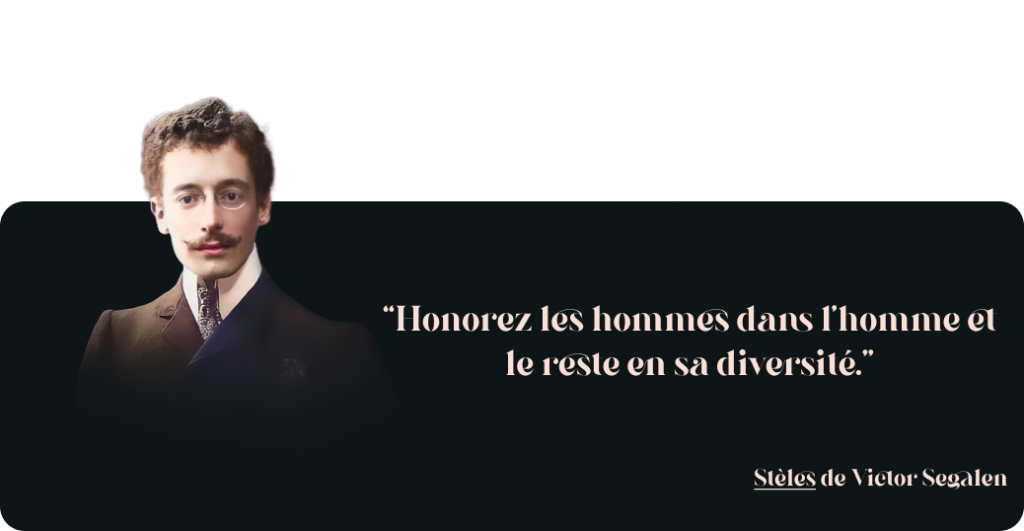
Parcours biographique
Victor Segalen semble avoir vécu plusieurs vies en une seule, pourtant restreinte à quelques décennies. Médecin de marine prêt à quitter pour de longues périodes sa Bretagne natale, écrivain puisant dans les pays lointains et les temps anciens l’inspiration d’œuvres novatrices, archéologue estimé de ses maîtres en sinologie, Victor Segalen a laissé une œuvre abondante dont la richesse a franchi le siècle passé pour rejoindre les lecteurs d’aujourd’hui.
Loin de Brest, son port d’attache, Segalen a trouvé dès son premier départ pour la Polynésie la confirmation de son intérêt pour les civilisations lointaines ainsi que les contours de son éthique et de son esthétique. A Tahiti, aux Marquises, puis sur le continent asiatique où la Chine devient son pays d’élection, bénéficiant de longs séjours permis par ses missions professionnelles, il explore d’autres univers culturels, avide de parcourir les lieux autant que de connaître le passé des civilisations côtoyées.
Ces expériences nouvelles l’amènent à concevoir une version personnelle de l’exotisme, distincte de la notion stéréotypée et galvaudée en ce début du XXe siècle. Segalen donne à la sensation d’exotisme une extension universelle englobant toutes les facettes des expériences vitales, à la fois sensorielles, intellectuelles et esthétiques. Elle recouvre toute confrontation avec ce qui est autre que soi, le « Divers », source de la saveur et de l’intensité de l’existence humaine pour celui qui se reconnaît « exote ».
Dès lors, vie et création puisent aux mêmes sources. Du séjour initial en Polynésie aux années passées en Chine entrecoupées de retours au pays natal, de nombreux écrits sont mis en chantier. Seules trois œuvres majeures, Les Immémoriaux, Stèles et Peintures paraîtront entre 1907 et 1916. Restituant des pans de la civilisation maorie (Les Immémoriaux), imprégnées d’emprunts culturels à la Chine, qu’il s’agisse de son histoire, de son écriture ou de sa peinture (Stèles, Peintures), elles présentent un caractère déconcertant et bibliophilique qui explique en partie que leur réception reste alors confidentielle bien que Segalen soit entré en relation avec plusieurs écrivains et artistes de son temps, parmi lesquels Claudel et Debussy ou George-Daniel de Monfreid, l’ami de Gauguin dont Segalen avait rapporté en France un bon nombre d’œuvres et de manuscrits peu après sa mort sur l’île de Hiva Oa en 1903.
La guerre de 1914 imposa un coup d’arrêt à la grande expédition archéologique que Segalen menait à travers la Chine et l’obligea à revenir en France. Les missions médicales, y compris sur le front en 1915, et la poursuite de son travail d’écriture remplirent ses quatre années de guerre d’une vie toujours aussi dense jusqu’à ce qu’une santé déclinante le conduise irrémédiablement à la mort en mai 1919.
À quarante-et-un ans, Segalen laissait de très nombreux manuscrits, certains presque achevés, d’autres manifestement en chantier. On doit au dévouement de ses proches d’avoir préservé les milliers de pages manuscrites et la correspondance, puis d’avoir favorisé la diffusion d’œuvres inédites et le travail des premiers chercheurs. Grâce en particulier à Annie Joly-Segalen à partir des années 1950, est apparue l’étendue d’une œuvre multiforme, née de la puissance créatrice et de la liberté d’esprit de Segalen, échappant à la répétition et aux cadres prédéfinis des genres littéraires. L’édition de Stèles, Peintures, Équipée au Club du meilleur livre a sans doute contribué à raviver le souvenir de Segalen mais il a fallu attendre qu’Henry Bouillier, auteur en 1960 d’une importante thèse universitaire sur l’auteur, fasse paraître les Œuvres complètes de Segalen en 1995 pour avoir en mains la somme d’une vie d’écriture. La parution en 2020 de deux volumes de ses Œuvres dans la collection de la Pléiade sous la direction de Christian Doumet consacre la reconnaissance tardive de l’écrivain.
Les lecteurs d’aujourd’hui perçoivent mieux combien Les Immémoriaux, Le Fils du Ciel, René Leys ou bien encore Le Maître-du-Jouir s’écartent des formules romanesques pratiquées en son temps. Comme ces fictions (auxquelles il faut ajouter les nouvelles réunies dans Imaginaires), les recueils poétiques (Stèles, Odes, Thibet), conjuguent les voix de deux cultures et explorent des ressources poétiques inédites. Si les œuvres théâtrales (Siddhârtha, Le Combat pour le sol, Orphée-Roi) restent identifiables en tant que textes promis à la scène, les journaux de voyage (Briques et Tuiles, Feuilles de route) sont également le laboratoire d’œuvres futures qui en seront détachées. Même la valeur scientifique de Chine. La Grande Statuaire n’efface pas la vision poétique qui sous-tend l’ouvrage. Quant aux recueils Équipée et Peintures, ils résistent à toute classification précise pour exprimer la confrontation au Divers et l’esthétique « spectaculaire » de Segalen.
La totalité de son œuvre s’ouvre ainsi aux lecteurs venus de multiples horizons, du lecteur amateur de littérature aux critiques littéraires, aux philosophes, ethnologues, historiens, artistes français et étrangers.
Parcours chronologique
1878 Naissance à Brest, le 14 janvier, de Victor, Joseph, Ambroise, Désiré Segalen. Son père, lui-même né en 1849, est instituteur. Il deviendra « écrivain du commissariat de la marine ». Sa mère, Marie Ambroisine Lalance, est également institutrice. Paris accueille une exposition universelle. Zola publie Une page d’amour ; Nietzsche, Humain, trop humain. Mallarmé a 36 ans ; Rimbaud, 24 ; Claudel, 10. Brahms achève son Concerto pour violon.
1888 V.S. au collège des jésuites de Brest, dit « Notre-Dame du Bon-Secours ». Initiation à la musique avec ses cousins Lossouarn. Du côté de sa mère, la branche Cras comprend Charles, qui deviendra médecin de la Marine, et Jean, futur amiral et compositeur de renom. À Bon-Secours, il rencontre Émile Mignard, Henry Manceron, Jean O’Neill et Max Prat qui resteront des amis fidèles.
1893 Échec au baccalauréat.
1894 Baccalauréat mention Assez Bien. Il entre au lycée de Brest en classe de philo. Reçu à la deuxième partie du baccalauréat avec la mention Très Bien.
1895 À la faculté des sciences de Rennes pour l’année de PCN. Sa mère et sa sœur s’installent avec lui à Rennes.
1896 Reçu premier au PCN sur cinquante-neuf. Retour à Brest, à l’École annexe de médecine navale. Prépare le concours d’entrée à l’École de santé navale de Bordeaux.
1897 Échec au concours. Retourne à Brest pour une nouvelle année de préparation. Avec son ami Émile Mignard, longues randonnées à bicyclette à travers la Bretagne.
1898 Reçu deuxième à l’École de santé navale de Bordeaux. Installation à Bordeaux. S’intéresse beaucoup à la littérature et à la musique.
1899 Sa mère, ayant appris son amourette avec Marie Gailhac, jeune fille de dix-neuf ans, manifeste une forte opposition. Premiers troubles nerveux. Ambroisine Segalen vient à Bordeaux et rencontre l’abbé Lelièvre, aumônier de l’École et informateur des parents. Chez l’abbé Lelièvre, V.S. rencontre le père bénédictin de l’abbaye de Solesmes, dom Thomasson de Gournay, ami de Huysmans. Il recommande le jeune homme à Huysmans, qui le reçoit à Ligugé le 1er août. Randonnée à bicyclette en Bretagne avec Mignard. V.S. tient le journal de ces promenades dans A dreuz an arvor. À Bordeaux, début de liaison avec Xavière Lonca, dite Saviéra.
1900 La liaison avec Savéria prend de l’importance. Plusieurs séjours à Ligugé et à Solesmes. Malaises que V.S. reconnaît caractéristiques de la « neurasthénie ». En novembre, grave dépression nerveuse. Il se fait mettre en congé de maladie. V.S. avoue à ses parents qu’il a de nombreuses dettes.
1901 Janvier : retourne à Bordeaux accompagné de sa mère et de sa sœur Jeanne. Elles resteront jusqu’en avril. Aussitôt après leur départ, il renoue avec Savéria. Rencontre le poète Saint-Pol-Roux. Première expérience de l’opium qui sera suivie de beaucoup d’autres, en Océanie et en Chine. Travaille à sa thèse de médecine. Il rencontre de nombreuses personnalités médicales et surtout littéraires à Paris. Remy de Gourmont l’accueille et l’introduira dans le milieu du Mercure de France.
1902 29 janvier : V.S. soutient sa thèse intitulée L’Observation médicale chez les écrivains naturalistes. Sous une autre présentation, sur grand papier, elle portait le titre sous lequel elle est aujourd’hui publiée : Les Cliniciens ès Lettres. Avril : « Les Synesthésies et l’école symboliste » paraît au Mercure de France. Il s’agit d’un fragment détaché de la thèse. Octobre : il s’embarque au Havre pour Tahiti sur la Touraine. Arrivée à New-York. Assiste au congrès d’archéologie américaine à la suggestion du Pr. Lejeal, rencontré sur le bateau. Pendant une nuit d’insomnie à New-York, il écrit son premier poème en prose, « La Tablature ». À San Francisco, V.S. est atteint de la fièvre typhoïde. Se juge assez gravement atteint pour se confesser. Convalescence d’un mois à San Francisco. Il en profite pour découvrir le quartier chinois.
1903 23 janvier : arrivée à Tahiti. Tournée à bord de la Durance pour porter secours aux sinistrés du cyclone qui s’était abattu sur l’archipel des Tuamotu, du 11 au 17 janvier. À la demande du gouverneur Petit, V.S. entreprend d’écrire un rapport sur le désastre. Le texte « Vers les sinistrés » paraîtra le 17 avril dans la revue Armée et Marine. Bonheur sous les tropiques avec son « épouse polynésienne », Maraéa. En février, se dessine l’idée des Immémoriaux. Mai : mort de Gauguin. Arrivé à Nuku-Hiva, capitale administrative des Marquises, au début du mois d’août, où V.S. examine de nombreux textes écrits et recopiés par le peintre. Rencontre des témoins de la vie de Gauguin, dont le fidèle Tioka. En septembre, deuxième vente aux enchères des biens de Gauguin. V.S. achète sept toiles, dont le Village breton sous la neige, quatre des panneaux de bois sculpté, des carnets, la palette du peintre …
1904 V.S. travaille à ce qui sera Les Immémoriaux. Juin : « Gauguin dans son dernier décor » paraît au Mercure de France. De septembre à février 1905, retour en France à bord de la Durance. Escale à Ceylan où V.S. s’initie au bouddhisme. Escale à Djibouti : souvenir de Rimbaud ; V.S. commence son étude sur Rimbaud.
1905 Épouse Yvonne Hébert, fille d’un médecin de Brest. Travaillant à son étude sur Rimbaud, rencontre Isabelle Rimbaud et Paterne Berrichon. Grâce à Charles Bargone (alias Claude Farrère), il rencontre Auguste Gilbert de Voisins. S’installe à Brest.
1906 V.S. écrit Pensers païens en même temps qu’il se consacre à la rédaction des Immémoriaux. Avril : naissance d’Yvon. Le lendemain, « Le Double Rimbaud » paraît au Mercure de France. Début de relations épistolaires avec Jules de Gaultier. Se présente à Claude Debussy pour lui soumettre l’idée d’un opéra sur son Siddhârtha.
1907 « Dans un monde sonore » paraît au Mercure de France sous la signature de Max-Anély. Debussy décline la proposition de composer sur Siddhârtha. Il suggère à V.S. de traiter le mythe d’Orphée. Tous deux commencent à collaborer à ce projet. Septembre : sortie des Immémoriaux, publié à compte d’auteur, sous la signature de Max-Anély. Octobre : « Voix mortes : musique maori » dans le Mercure musical. V.S. songe à écrire une sorte d’épopée, Le Maître-du-Jouir, dont le héros serait Gauguin. Décembre : à Paris, il visite longuement le musée Gustave-Moreau.
1908 V.S. commence à envisager de se faire affecter en Extrême-Orient. Il se met à l’étude du chinois. Installé à Paris, il suit les cours de Vissière à l’École des langues orientales, et de Chavannes au Collège de France.
1909 V.S., reçu à son examen d’élève-interprète de la marine, obtient un détachement en Chine sans autre obligation que de se perfectionner dans la langue chinoise. Le 25 avril, il s’embarque seul pour la Chine à Marseille sur le paquebot Sydney. Auguste Gilbert de Voisins doit le retrouver plus tard à Pékin. Escale à Colombo, où il évoque le texte de Claudel sur Ceylan, dans Connaissance de l’Est. Le 12 juin, il arrive à Pékin. Le 15, visite au Consulat de France à Tianjin où il rencontre Claudel. Gilbert de Voisins ayant rejoint Pékin, les deux amis partent le 9 août vers le sud-ouest, en direction de Baoding. L’expédition, dont les lettres presque quotidiennes adressées à Yvonne fournissent un compte-rendu détaillé, les conduira à travers les provinces du Shansi et du Shaanxi jusqu’au Sichuan. À la mi-décembre, ils s’embarquent sur une jonque pour descendre le Yangzi. À Chongqing, ils rencontrent Jean Lartigue, jeune officier à bord du Doudart de Lagrée et futur membre de l’expédition de 1914. De son expérience fluviale, V.S. tire le très beau texte qui deviendra Le Grand Fleuve. Ils arrivent le 28 janvier à Shanghai. Chemin faisant, les projets d’écriture se multiplient. La veille du départ (le 8 août) est née l’idée du Fils du Ciel. En septembre, il annonce l’avancée d’une nouvelle, « La Tête », destinée à figurer dans un ensemble intitulé Imaginaires, cependant qu’au fil des journées de voyage, il accumule « un amalgame de fragments, de proses, d’inventions » réunis sous le titre de Briques et tuiles.
1910 Début février, V.S. et Auguste Gilbert de Voisins s’embarquent pour le Japon. Visitent Nagasaki, Kobe, Osaka, Kyoto et Tokyo. Ayant retrouvé sa femme et son fils à Hong-Kong, V.S. séjourne avec eux à Pékin. En juin, rencontre de Maurice Roy, fils du Directeur de la poste française de Pékin. Agé de dix-neuf ans et complètement bilingue, celui-ci donne à V.S. mille détails sur la Cité interdite et sur la famille impériale. Les Annales secrètes d’après MR et le roman René Leys sont fondés sur les révélations rocambolesques de ce personnage. Septembre : rédaction de la première stèle, « Empreinte ».
1911 Le stage d’élève-interprète arrive à expiration. V.S. succède au docteur Gérald Mesny qui vient de mourir en luttant contre une épidémie de peste en Mandchourie. Mai : fin de l’épidémie. V.S. s’installe avec sa famille à Tianjin. Cours à l’Imperial Medical College. Octobre : V.S. prend parti pour le maintien de l’Empire et retourne à Pékin avec sa famille, malgré la révolution.
1912 Août : composition de Stèles sur les presses du Pei-T’ang. Tirage à 81 exemplaires, plus un certain nombre (environ 200) sur vélin parcheminé. Travail à la rédaction du Fils du Ciel, et amorce ce qui deviendra Peintures et Odes. Naissance d’Annie. Octobre : V.S. accepte de devenir le médecin chargé de soigner le fils de Yuan Shikai. Projet d’une fondation sinologique française à Pékin.
1913 V.S. entreprend de refaire Le Repos du septième jour de Claudel. C’est le début du Combat pour le sol. Le système de La lettre commencé au début de l’année fonctionne avec les contributions de Bons d’Anty, Charles de Polignac, Albert Erlande et Pierre d’Ythurbide. Mars : il quitte son poste et retourne à Pékin, puis à Tianjin où il reprend ses cours à l’Imperial Medical College. Du 5 juillet au 17 octobre : V.S. rentre seul en France. Gilbert de Voisins lui propose de faire une nouvelle expédition en Chine. Diverses démarches auprès des sinologues Cordier et Chavannes, de Jacques Doucet, du Ministère des Affaires étrangères, pour préparer la nouvelle expédition, cette fois officielle. Octobre : départ pour la Chine avec Gilbert de Voisins et Suzanne Hébert, sœur cadette d’Yvonne. Arrivée le 1er novembre à Tianjin, une demi-heure après la naissance de Ronan. Novembre : départ pour Pékin avec Gilbert de Voisins pour préparer l’expédition archéologique et la publication des trois premiers titres de la « Collection coréenne » commanditée par l’éditeur Crès : nouvelle édition de Stèles, Connaissance de l’Est, L’Histoire d’Aladin et de la Lampe merveilleuse. Travaille également au roman qui deviendra René Leys.
1914 1er février : départ de l’expédition archéologique. Visite aux grottes bouddhistes de Longmen. Découverte de l’emplacement de la tombe de l’empereur Shihuang, sur le site où soixante ans plus tard on fera la plus grande découverte archéologique du siècle. Mars : découverte du Cheval piétinant un Barbare sur la tombe de Huo Quping, la plus ancienne sculpture monumentale connue en Chine. Mai : projet d’Équipée. Août : nouvelle du déclenchement de la guerre en Europe. Segalen, Voisins et Lartigue renoncent à gagner le Tibet. Ils rejoignent Hanoï où les retrouve Yvonne Segalen. Départ pour la France sur le Paul Lecat. Octobre : V.S. à l’hôpital de Rochefort. À la fin du mois, séjour à Bordeaux où il rencontre au cours d’un déjeuner Claudel et Alexis Leger. Novembre : V.S. affecté à l’hôpital de Brest.
1915 Mai : V.S. affecté à la brigade des fusiliers marins de l’amiral Ronarc’h, à Dixmude. Juillet : hospitalisé à Zuydcoote pour une gastrite aiguë. Octobre : affecté à l’hôpital maritime de Brest pour des tâches administratives.
1916 Travaille aux projets du Fils du Ciel et à René Leys. Mai : à Paris où il revoit Debussy, Monfreid, Voisins, Polignac, Laloy, Edmond Jaloux et Giraudoux. Juin : dernière lettre de Debussy qui renonce à Orphée. Achevé d’imprimer de Peintures chez Crès.
1917 V.S. est nommé Médecin militaire chargé d’examiner des volontaires chinois destinés à travailler dans les usines d’armement françaises. Voyage par Londres, la Suède, Petrograd où il reste une dizaine de jours, peu avant le déclenchement de la révolution. Février : arrivée à Tianjin. Mars : à Nankin, V.S. corrige les épreuves de l’Hommage à Gauguin. Recrutement des travailleurs chinois. Étude sur la grande statuaire de Liang. Visite aux « chimères » des environs de Nankin. À Shanghai, visite au tombeau du fils du « roi de Wou ». V.S. commence à concevoir un essai sur la grande statuaire chinoise. Juin : retour à Pékin. Alexis Leger également à Pékin à ce moment-là. Juillet : V.S. quitte Pékin pour la dernière fois. À Hanoï, il commence à concevoir son poème Thibet. Retour à Shanghai où il embarque les travailleurs chinois pour Marseille, sur le Warimoo.
1918 V.S. arrive le 2 mars à Marseille. À Brest pour un congé d’un mois prolongé par quatre semaines de congé de maladie. Il rencontre Hélène Hilpert, amie d’enfance de sa femme. Mai-juillet : installation à Paris pour un stage à l’Hôpital militaire du Val-de-Grâce. En juin, congé de deux semaines au Cap Coz avec sa femme et Hélène Hilpert. V.S. nommé chef du service de dermatologie et de vénérologie à l’hôpital maritime de Brest. Septembre : épidémie de grippe espagnole. V.S. travaille jusqu’à l’épuisement à l’hôpital. Il travaille aussi activement à ses manuscrits : Thibet, Chine, la grande statuaire. Dès l’armistice, tente de faire avancer son projet d’Institut de sinologie. Son état de santé s’aggrave.
1919 Janvier : hospitalisation au service de psychiatrie du Val-de-Grâce. Congé de convalescence de deux mois. Invité par Charles de Polignac dans sa propriété en Algérie de Bouzareah, près d’Alger. État dépressif aigu que V.S. avoue à Hélène Hilpert dans une série de lettres écrites du 16 février au 27 mars. Mars : nouveau congé de convalescence. Avril : V.S. reçoit enfin une réponse de Claudel à sa lettre du 3 octobre précédent, où il exprimait sans doute un certain désarroi spirituel. Lettre à Jean Lartigue dans laquelle il indique que les analyses ne révèlent aucun symptôme pathologique, et qu’il a presque totalement renoncé à l’opium. Se rend seul à la forêt de Huelgoat qu’il aimait particulièrement. Va à Morlaix rendre visite à son ami Max Prat. Décide de poursuivre vers Paris afin de rencontrer Claudel. Mais la peur de voir Claudel exercer sa « ferveur apostolique » lui fait faire demi-tour au Mans. Mai : lettre à Hélène Hilpert dans laquelle il s’efforce de définir la nature de ses sentiments et de leur attirance réciproque. Les 17-18 : séjour avec sa femme au Huelgoat. Fin mai, il écrit deux lettres, l’une à sa femme, l’autre à Hélène Hilpert, la première exprimant une confiance dans l’avenir, la seconde avouant un épuisement physique total. Le 21, il quitte l’hôtel d’Angleterre muni d’un repas froid et se rend dans la forêt. Comme il n’est pas rentré depuis deux jours, sa femme arrive de Brest et se rend immédiatement avec Hélène Hilpert à un de leurs « endroits consacrés ». Son corps gît sans vie, blessé au talon. V.S. avait confectionné un garrot de fortune. 26 mai : cérémonie religieuse au Huelgoat et enterrement dans le cimetière local.

